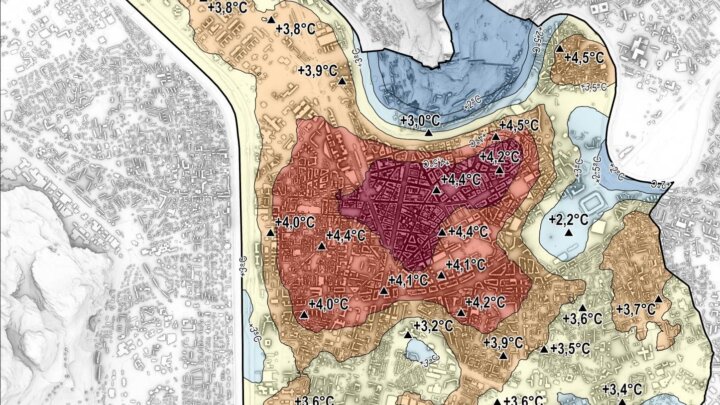La précarité hydrique des Outre-Mer en question
Pourquoi l’accès à l’eau dans les départements et régions d’Outre-Mer est-il encore défaillant ? Deux chercheuses spécialistes du droit à l’eau en Outre-Mer partagent leur vision avec TSM. Doctorante en géographie à l’Université Lyon 3 Jean Moulin et cofinancée par l’Office de l’Eau de la Martinique, Oméya Desmazes étudie depuis février 2022 dans le cadre de sa thèse les conditions d’accès à l’eau potable en Martinique. Docteure en urbanisme, Maëlle Nicault a soutenu en mai 2023 une thèse sur la gestion de l’eau du cirque de Mafate, encadrée par l’université de Grenoble Alpes et l’Université de La Réunion.

TSM : La précarité hydrique des populations en Outre-Mer reste problématique à comparer à celle de l’Hexagone. Pourquoi l’eau est-elle encore aujourd’hui perçue comme un facteur d’inégalité sociale en Outre-Mer ?
OD : Pour comprendre les relations à l’environnement et à l’eau en outre-mer, il est important de faire un détour par l’histoire. Les départements et régions d’Outre-Mer (DROM) ont en commun une histoire de colonisation et d’esclavage ; on peut parler de matrice de la plantation. La Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane ont été marquées par la loi de départementalisation qui a changé le statut de ces 4 anciennes colonies françaises en 1946 et qui n’est intervenue qu’en 2011 à Mayotte. Mais leurs paysages, leur agriculture et même la gestion de l’eau ont conservé les empreintes de la colonisation. La pollution au chlordécone de la Martinique et de la Guadeloupe liée à la monoculture de banane jusque dans les années 90 illustre la persistance d’une économie d’exportation sur ces territoires.
Envie de lire la suite ?
J’achète cet article
- Accès à l’intégralité de l’article
- Téléchargement PDF
Je m’abonne à la revue TSM
- 10 numéros par an, versions papier et web
- Accès aux articles Magazine et Partage Opérationnel
- Téléchargement des numéros et des articles en PDF
D'autres articles
sur le même domaine.